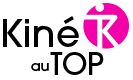Tendinopathie latérale du coude : où en sommes-nous d’après la science ?
La tendinopathie latérale du coude, plus communément appelée “tennis elbow”, est une affection fréquente chez les travailleurs manuels et les sportifs réalisant des gestes répétitifs. Son origine est souvent multifactorielle, et sa prise en charge repose en pratique sur une rééducation active et progressive, mais aussi bien d’autres options thérapeutiques plus ou moins étudiées.
Actuellement, les approches les plus utilisées incluent les exercices excentriques, isométriques et isotoniques sans qu’aucune modalité spécifique ne démontre une supériorité avérée.
D’autres approches existent, qu’il s’agisse de thérapie manuelle, d’ondes de chocs, de dry needling, ou encore des agents physiques.
Par Arnaud Van Marcke et Frédéric Srour.

Priorité au diagnostic différentiel

Le diagnostic d’une tendinopathie latérale du coude peut paraître évident, mais il est bien souvent surestimé du fait d’un défaut d’établissement de diagnostic différentiel.
Bien des pathologies peuvent mimer une douleur ponctiforme à l’épicondyle latéral, comme une atteinte du ligament collatéral radial ou une atteinte osseuse. Néanmoins il n’existe peu de pathologies qui peuvent imiter la tendinopathie latérale depuis l’épicondyle jusqu’à l’avant-bras. La plus récurrente est l’atteinte du nerf radial.
Bien qu’une atteinte nerveuse puisse être accompagnée de symptômes la différenciant aisément d’une tendinopathie, tels que des signes en lien avec le questionnaire DN4, il arrive souvent que seule une mécano-sensibilité du nerf radial soit objectivable.
Le piège vient du fait que la tendinopathie latérale et la mécano sensibilité du nerf radial peuvent provoquer une douleur à l’extension active du poignet ou à la flexion passive du poignet (‘étirement des épicondyliens’). L’extension du coude l’irritera également, comme le montre l’ULNT radial. Une différenciation structurelle avec la recherche d’une modification de symptôme sera donc cruciale, par l’intermédiaire de la nuque ou de la scapula principalement, afin de s’assurer de l’absence d’une mécano-sensibilité radiale.
Ce n’est qu’après cette étape, et après avoir écarté les autres diagnostics différentiels, que le kinésithérapeute peut envisager le traitement de tendinopathie latérale de coude.
Mais de quel traitement parlons-nous exactement ? Voyons cela plus en détail.

Approches thérapeutiques en fonction du niveau de preuves
Les exercices : une base incontournable
Les exercices constituent l’élément central du traitement de la tendinopathie latérale du coude. S’il n’existe pas de consensus sur la supériorité d’un type de contraction musculaire sur un autre, il est établi qu’un renforcement progressif et adapté à la situation clinique, notamment à l’irritabilité, est essentiel pour restaurer la fonction à long terme.

Ainsi, plutôt que de privilégier une seule approche, les données actuelles indiquent qu’une combinaison des différentes modalités d’exercice, adaptée à l’évolution du patient, représente la stratégie la plus efficace.
Thérapie manuelle et techniques complémentaires : quel intérêt ?


La thérapie manuelle, incluant les mobilisations articulaires et les techniques de mobilisation avec mouvement (MWM), peut être utile pour réduire la douleur et améliorer la mobilité. Toutefois, son efficacité sur la fonction et l’analogie à long terme ne semble pas être appuyée par les données de la littérature.
D’autres modalités de traitement sont parfois proposées :
Si ces techniques peuvent compléter la rééducation, elles ne doivent jamais se substituer à un traitement actif et progressif.
Ce qui est bien étudié versus ce qui reste incertain
Les exercices thérapeutiques sont aujourd’hui bien étudiés, et leur efficacité sur la récupération fonctionnelle est bien documentée. Bien que l’évolution naturelle de cette pathologie soit plutôt favorable, les exercices semblent augmenter, voire accélérer cette évolution.
À l’inverse, des approches telles que les ondes de chocs, le dry needling ou l’électrothérapie, bien que populaires, ne disposent pas encore de preuves suffisantes pour justifier leur emploi systématique.
Il est donc essentiel de distinguer les techniques bénéficiant d’un fort niveau de preuves de celles qui reposent encore sur des hypothèses ou des études de faible qualité méthodologique.

Conclusion

La prise en charge en kinésithérapie de la tendinopathie latérale du coude repose avant tout sur un renforcement progressif et structuré, sans qu’aucune modalité spécifique d’exercice ne se démarque clairement. Les techniques complémentaires peuvent apporter un soutien ponctuel mais ne doivent pas remplacer l’approche active. Les professionnels de santé doivent s’appuyer sur les données scientifiques les plus robustes pour proposer un traitement efficace et individualisé, en intégrant les dernières avancées et les besoins spécifiques de chaque patient.
La Note au TOP
Lorsque l’on réfléchit à la fonction des muscles épicondyliens, on constate qu’ils jouent le plus souvent un rôle dans la stabilisation isométrique du poignet lors des activités impliquant l’usage de la main et de l’épaule.
Les plaintes les plus courantes concernent d’ailleurs majoritairement des activités sans mouvements amples de poignet mais requérant plutôt de la stabilité (tenir une raquette, passer l’aspirateur, lever une chaise,…). Rares sont les gestes du quotidien nécessitant une grande extension de poignet, qu’elle soit excentrique ou concentrique (essorer un tissu trempé par exemple).
Ainsi, au-delà des exercices excentriques bien connus dans le traitement des tendinopathies, une prise en charge pertinente devrait selon nous systématiquement inclure un travail spécifique sur la stabilité du poignet, qu’elle soit isométrique ou isotonique.
En s’appuyant sur les activités de la vie quotidienne, il devient évident que renforcer ces capacités stabilisatrices est crucial pour une rééducation optimale et une récupération durable. Bien entendu, en cas d’activité ou de sport spécifique au patient qui nécessiterait des mouvements amples de poignet, il sera crucial d’adapter notre prise en charge, car comme toujours nous ne traitons pas une pathologie, mais bien un patient, avec ses propres objectifs.